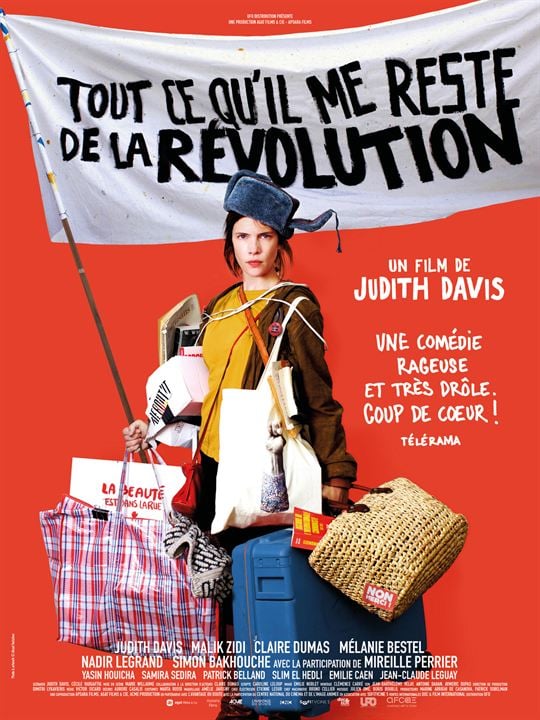C’est ce que nous sommes, je pense.
Au balbutiement du langage.
Qui s’aperçoivent, interloqués, légitimement suspicieux,
rassurés.
Le langage, inapproprié, à inventer, encore, peut servir à
communiquer, aussi.
A faire espèce, au moins un peu. Parce que même les fauves
solitaires aspirent à faire clan, au moins de temps en temps.
La démystification, la « déconstruction » si l’on
veut, l’incroyance devant les idoles, quand elle n’est pas qu’une danse de
salon, sert aussi à nous débarrasser, nous alléger des contraintes inutiles,
nous sauve de quelques fourvoiements. Dés-espérante et desséchante, quand elle
n’est qu’une posture, elle peut aussi faire préalable à un sens reconstruit,
plus cohérent, nettoyé.
Je crois que l’action de penser, pour ne pas l’appeler
« philosophie », terme mal fréquenté, compromis, revient toujours,
comme aux « origines », à se fabriquer des outils, pour aménager la
cabane et chasser le mammouth. Aménager au mieux notre île de Robinson.
Continuer à inventer le langage, pas pour faire neuf, ni
beau (pour ça aussi, si ça chante), mais pour faire le tri, remplacer les mots
usés, inadéquats, qui voilent et altèrent le réel. Se défaire des vieux
concepts, pas parce qu'ils sont vieux, faire le tri, jeter ceux qui ne
fonctionnent pas, ou plus, en forger d’autres : pas pour surprendre le
bourgeois, ou faire le pitre dans les galeries (pour ça aussi, si ça nous
enchante), le fou des rois ou le caniche de ces dames.
Il faudrait reprendre le chantier là où il en est resté,
inachevé. Voir « ce qu’on fait maintenant », plutôt que de se
complaire à une pensée de la répétition, à une glose radotante. Tirer les
leçons des cinq derniers siècles : l’impasse du progressisme humaniste,
cette théorie du ruissellement dont on doit aujourd'hui admettre qu’elle ne
fonctionne pas : des Penseurs qui théorisent, d’autres qui vulgarisent, et
une masse dont la capacité de penser augmenterait, se raffinerait sous l’effet
de « l’éducation », émancipation du grand nombre garante d’un mieux
pour tous.
La libération par les Lumières, la révolution par les
progressistes, ça ne marche pas : très bien, pas grave : qu’est-ce
qu’on fait ? Remplacer les concepts marxistes de la lutte des classes,
insuffisamment affinés, non à jeter mais à repolir ; la vision binaire,
stérile et inadéquate, oppresseurs/opprimés, puisqu’on a expérimenté que les
uns et les autres sont l’un et l’autre, que la frontière de l’affrontement ne
passe pas tout à fait par là, que c’est plus complexe, que ce sont des
catégories inopérantes : là est pour moi le vrai point de la réflexion
politique. Redécouper les catégories du réel, conçues selon des modes
antagoniques, hommes/femmes, noirs/blancs, riches/pauvres,
progressistes/réactionnaires, dominants/dominés. Penser en termes
d’intrications, de définitions multiples, mobiles et non statiques,
réversibles.
Se poser ces deux questions : quoi faire à l’endroit où
nous sommes arrivés, et celle du statut du penseur-individu, des limites de la
portée de celui qui s’interroge, isolé, donc peu audible : la contradiction
entre la dimension intrinsèquement individuelle de « là où ça pense »
et celle intrinsèquement collective de « là où ça agit », double
condition d’une efficacité. Alors l’action de penser me semble redevenir
joyeuse, qui fait vie : also sprach
Zarathustra !
Seul moyen, me semble-t-il, pour que l’action de penser ne
se réduise pas à « un condensé d’impuissances et d’échecs ». Le
sentiment de « l’échec » me semble ne relever que des attentes qu’on
a pu se laisser fixer, par une société, un système de formulations qui placent
le « succès » dans la seule reconnaissance du pouvoir ou du nombre.
Il n’est dans le formatage permanent de notre imaginaire que de grands philosophes, écrivains,
politiques, artistes, savants, c'est à dire adulés (par le nombre) ou adoubés
(par les cercles de pouvoir). C’est dire que leur « réussite » a pour
prix, pour condition de recevabilité, leur impuissance, leur engagement tacite
ou assumé à ne rien faire, à ne rien
changer de l’ordre (et des désordres) du monde, dont ils sont redevables. C’est
la loi de leur accession et maintien dans la caste mandarinale. Qu’un Bourdieu
vienne cracher dans la soupe, secouer le cocotier, et, après qu’on a échoué à
l’étouffer, à l’éliminer (voir le court-métrage de son fils, Le Candidat), sa consécration inévitée
se solde par une assimilation aux formes indolores de l’expression
universitaire : telle est la terrifiante et auto-destructrice efficacité
du système « libéral », sa plasticité, qui lui permet d’absorber, de
digérer ce qui vient le menacer. De ce fait, rien ne peut venir sauver le
système de lui-même, comme des cellules malignes qui auraient acquis le pouvoir
de transformer les leucocytes en nouvelles cellules malignes. Le gain,
puisqu’il y en a forcément un, étant la conservation des personnes en profit.
Exemple semblable de l’outsider Onfray, dont la para-université est une
université …
Soit le dilemme entre « réussir » (être publié, reconnu,
recruté, considéré : assimilé) comme autre que soi, accepter de passer
sous les fourches caudines, se conformer (vendre son âme, dans les anciennes
terminologies), ou rester soi mais à l’écart : dialectique de l’individuel
et du collectif. N’être « rien », puisque c’est le groupe qui nomme,
qui reconnaît, rien que soi,
forcément chétif, ou être « quelqu'un », mais quelqu'un d’autre. La
danse du courtisan, fût-ce de cours marginales ou minoritaires, comme s’y
décident maints « opposants » et rebelles : il n’y aurait à
choisir que la secte dont on puisse devenir l’officiant.
Dernière idée, qui assemble les autres : forger le
concept d’une double intrication du collectif et de l’individuel, de l’élément
et de l’ensemble, qui rend compte de bien des « contradictions »
apparentes dans certaines carrières, positions, théories. Mon destin individuel
est évidemment un élément de l’histoire collective, dans laquelle j’occupe un
point paramétré (1e intrication). Mais à l’inverse, l’histoire
collective, et le rôle que j’y joue ne sont que des éléments dans l’ensemble de
« ma vie ». Le théoricien, même étiqueté contestataire, le leader
politique, même « opposant », quand il pense le monde, les
changements qu’il prétend y apporter, ne peut que simultanément bien que contradictoirement
œuvrer pour lui-même, dans son intérêt sinon exclusif du moins prioritaire
(qu’il s’agisse de son confort, son salaire, sa position sociale, sa satisfaction
narcissique). De là ce jeu de dupes où d’aucuns prétendent (et se font croire,
parfois) combattre un système dont ils dépendent, dont ils ne peuvent en
réalité provoquer la disparition : contradiction qu’ils résolvent par la
mise en scène d’un simulacre.
On en serait là, et, c’est excitant comme un suspense de
film d’aventures, cela étant : qu’est-ce qu’on peut inventer pour se sortir
de là ? La chasse au mammouth à poursuivre …