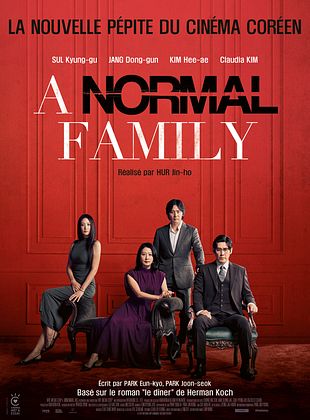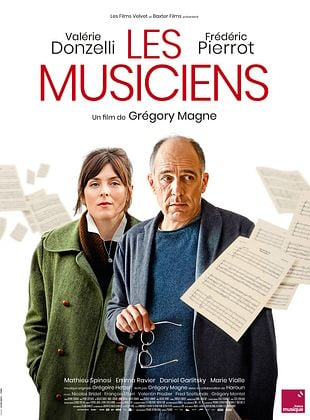La question de « l’existence des femmes »
C’est une question qui renvoie à la fois aux façons dont nous nous construisons une « identité collective », à la notion même de catégorie, aux choix inconscients que présuppose la langue, aux découpages que nous imposent les mots, à leurs fonctions mêmes.
Est-ce que ça existe, « les femmes » ? En face, voire à l’opposé, des « hommes », comme catégorie distincte, constituée ? Est-il pertinent de diviser ainsi l’ensemble des humains, avec quelles implications, conséquences ? Qu’avons-nous à gagner, et à perdre, avec une telle vision ?
La position « simple », traditionnelle, forte de son « évidence » empirique est que « bien sûr, que nous sommes homme ou femme ». Ça « se voit », comme on voit bien qu’il y a des Noirs et des Blancs. Aux uns et aux autres, les traditions de la plupart des civilisations (mais pas de toutes) attribuent des caractères propres, des capacités et des incompétences supposées, des « qualités » et des « défauts » que la pensée contemporaine a entrepris de contester, de réfuter : en ce que cet essentialisme ancestral constituait d’assignation réductrice, de croyances infondées, au mieux résultats et non sources de conditionnements dès le plus jeune âge, de comportements appris et non « naturels », et donc de limitations aux aspirations et à la liberté d’agir et de se comporter, aujourd'hui rendues caduques, au moins en partie, pour la fraction éduquée des sociétés occidentales.
La femme, « sexe faible », sur les plans physique, psychologique, intellectuel et moral (comme les « races inférieures ») ne pouvait « logiquement », et encore moins décemment, faire du sport, se battre, commander, diriger un pays, décider de leur sexualité, de leur partenaire amoureux, de leurs choix vestimentaires ou professionnels, etc.
C’est contre ces inégalités que s’est battu le « féminisme », le mouvement d’idées prônant une égalité des sexes : pourtant, les croyances en une différence des sexes restent dominantes dans une majorité de pays, et, même dans ceux où la loi stipule une égalité de principe, elles subsistent encore avec force dans la mentalité du plus grand nombre. Il semble même qu’elles trouvent un regain de vigueur (parallèlement aux croyances racistes et aux aspirations à des régimes autoritaires).
Le débat se complique d’une subdivision des positions féministes : l’universalisme, qui conteste l’existence de deux sexes (comme celle des « races »), autrement que comme un produit, contingent, l’éducation, et modulable, donc, par elle. Ce que semble contester un néo-féminisme, qui rétablit une distinction, voire un antagonisme, entre les sexes : il existerait bien une réalité de la féminité, dépourvue toutefois d’une quelconque infériorité.
Je devrais avoir toutes les raisons de croire à l’existence d’une catégorie féminine, que semble attester ma propre « expérience » d’ « homme ». « Mâle et femelle Il les créa. »
Comme toi, j’ai une prédilection pour les romans écrits par des femmes (du moins, par certaines) : c’est en eux que je trouve ce qui m’importe aujourd'hui dans une œuvre : la scrutation, le récit et l’analyse des faits du quotidien, de la vie intérieure et intime, l’attention fine aux signes discrets des émotions et des relations. A croire qu’on retomberait sur l’antique opposition entre la « sensibilité » féminine » et les appétences plus cérébrales des auteurs hommes. On trouverait probablement des contre-exemples : mais c’est souvent un gage de trouver ce que je recherche en sélectionnant des auteurs désignées comme femmes. Parmi les contre-exemples possibles, le cas de cette italienne, Anna Ferrante, dans son cycle de L’Amie Prodigieuse, mais dont on ignore tout, justement, quant à son identité réelle. S’il s’agissait en fait d’un homme, cela interrogerait sur la façon dont il a pu accéder à une telle connaissance intime des réalités féminines : observation, confidences, collaboration d’une autrice …? Mais hommes et femmes ne peuvent-ils être pareillement doués de l’empathie, du talent de « se mettre dans la peau » de toutes sortes de personnages, sans quoi un auteur serait limité à n’écrire que sur sa propre vie ? C’est peut-être par les thèmes qu’ils abordent, et ce qu’ils en disent, qu’auteurs hommes et femmes se distingueraient. Sans que cela constitue indiscutablement la marque d’une différence essentielle : on peut ne voir là qu’un effet, d’une part, des persistances de différences en matière d’éducation ; et, d’autre part, et surtout, des fortes disparités sociales encore vécues par les hommes et les femmes : nos sociétés n’instituent pas pour les uns et les autres les mêmes relations au corps, à l’argent, à la famille, aux responsabilités parentales, au pouvoir, etc. , toutes réalités qui tissent une œuvre. Les pesanteurs, les traditions, les représentations, encore largement sexistes, ont tendance à construire des disparités de genre. Sans qu’on puisse dire pour autant que ces expériences du corps-argent-famille-fonctions soient vécues de façon identique et unanime à l’intérieur de ces catégories supposées. D’autres paramètres interviennent, classe sociale, groupe ethnique, caractéristiques psychologiques, qui interfèrent avec ceux du genre. L’expérience vécue par un homme et une femme de mêmes milieux pourraient être bien plus semblables que celle vécue par deux femmes ou par deux hommes de milieux différents.
Au collège, les conversations entre camarades, particulièrement le lundi, me faisaient préférer la compagnie des filles : celles des garçons tournaient essentiellement autour des résultats sportifs du week-end, c’était avec les filles que je pouvais « parler de la vie », aborder les questions qui m’intéressaient, sentiments, relations, expériences psychologiques. Les garçons me paraissaient péniblement limités à des préoccupations de pouvoir, des activités célébrant leurs prouesses physiques, tout ce qui flattait leur soif de domination. Centres d’intérêt qui m’apparaissaient comme futiles, dérisoires, vides.
Ces apparentes oppositions de genre peuvent avoir pour causes les injonctions sociales pesant sur l’un et l’autre sexe. L’imitation des modèles incarnés par les adultes ; une éducation inhibant les domaines de la sensibilité chez les uns, et la libérant chez les autres, les filles se trouvant plus facilement déchargées du poids d’avoir à prouver en permanence sa « force ». C’est ce qu’il m’a semblé constater ensuite : j’ai trouvé, dans les classes postérieures, de plus en plus de copains intéressés par les sujets « humains », et comme moi narquois face aux « exploits sportifs ». Et bien des filles aujourd'hui, enfin admises dans la pratique sportive, manifestent le même intérêt pour les performances, les scores de matchs, les résultats de compétitions.
On trouve malgré tout la même prévalence, à l’âge adulte, des femmes dans les activités littéraires : dans les ateliers d’écriture, les hommes existent, mais ils sont rares. Rien qui contredise là encore l’hypothèse des conséquences d’une éducation, et de modèles sociaux, encore très largement genrés.
J’ai eu quelques amis hommes avec qui il était possible de communiquer sur nos vies intérieures et intimes, le « parler de soi » à côté de discussions politiques, ou théoriques. L’accès des hommes au monde intérieur est possible, mais il reste rare, encore souvent verrouillé par l’injonction faite aux hommes de se défier de tout ce qui est « faible » : révéler ses failles, ses souffrances, ses questionnements, découvrir que c’est là pourtant que réside une source incommensurable de notre humanité. « Un homme, ça ne pleure pas. » C’est essentiellement en la compagnie des femmes que je trouve ce qui m’importe le plus : le partage des expériences et des émotions, le goût de raconter « ce qui nous est arrivé » : la communication. C’est avec des femmes que j’ai le plus souvent correspondu. Avec des hommes, j’ai écrit des romans. C’est donc qu’elles « existent ». Qu’il y a bien une catégorie dont j’ai éprouvé la spécificité, que je privilégie pour partager l’écoute, la communication fine et sensible. Chez presque tous les hommes que je connais, on ne « se met pas en danger », on en reste à l’impersonnel, on n’a pas le désir de voyager en l’autre, dans le monde de l’autre. Mais c’est également le cas chez la plupart des femmes : il semble que cette prudence distante soit plus un trait sociétal de l’humain, que les stéréotypes de genre ancrent plus fréquemment chez ceux qu’on a assignés à une identité « masculine ». Mais dont ils soient tout à fait capables de se libérer, si leur désir et les circonstances les y poussent.
Et puis, bien sûr, et surtout, le « sexe ». La sensualité. L’émotion puissante devant la beauté. J’ai toujours été un « passionné des femmes », comme je le suis de certaines musiques, de l’écriture, de la douceur. Ce bouleversement total et vital devant « la beauté d’une passante ». Ce qui naît et se noue avec une femme, avec certaines femmes, l’embrasement de l’âme et des sens, l’urgence de se connaître, de se lancer à la découverte de l’autre, les voluptés de se rencontrer, le partage d’un essentiel qui rend la vie vivante, digne d’être vécue. Et l’anéantissement quand la relation finit, ce vide interminable quand on trouve au petit matin un mot, « je suis rentrée en Allemagne ». Quand cesse ce qui était beau, sans qu’on ait compris, parfois, « pourquoi ». Les souffrances du jeune Werther. Cela, je ne l’ai éprouvé, vécu, qu’avec des femmes. Aussi fortes et joyeuses qu’aient pu être mes amitiés masculines. Là, il n’y a pas de « question » : mais l’évidence, magnifique et tragique, des femmes.
Et pourtant, je ne me sens pas faire partie d’un peuple qui serait celui des hommes. Je ne me reconnais rien de semblable, rien d’essentiel en tout cas, avec ceux qui seraient mes congénères. Je ne partage pas leurs enthousiasmes et frénésies pour les rencontres sportives. Je ne me sens pas tenu de manifester une quelconque « virilité », qualité tautologique qui mêlerait musculature et transpiration, performances et domination, affirmation de soi et conquêtes de territoires, titres, possessions ou trophées don-juanesques, qui me paraissent plutôt relever du règne du gorille. Ni homme ni femme, si peu humains.
De même que la coloration plutôt blanche de ma peau, mes origines petites-bourgeoises et béarnaises, ma nationalité indubitablement française ne me rendent ni solidaire ni partisan des exactions commises par les détenteurs des mêmes « caractéristiques » apparentes, qui ne me semblent pas pouvoir me caractériser. Je me sens plus désireux d’une liberté et d’une égalité véritables entre hommes et femmes, de toutes carnations et nationalités, que bien des femmes ou des peuples victimes de discriminations.
Je me méfie de la croyance qu’il existerait une identité essentielle qui, angéliquement, disposerait à une bienveillance universelle, quand celle « contraire » condamnerait à agir en bourreau. J’ai rencontré toutes sortes de femmes « tyrannes », aussi désireuses de pouvoir et de domination que n’importe quel homme, je ne vois pas de différence marquée quant au service de leur intérêt. Les exemples politiques et historiques ne manquent pas. Je vois là un des principaux risques d’établir une différence a priori entre « hommes » et « femmes », comme nous y poussent certaines représentations : celui de se tromper d’ennemi. De voir chez certains, alliés possibles, des adversaires systématiques. Et de ne pas discerner les pouvoirs de nuisance de certaines, au motif qu’il s’agirait de femmes : à ce titre épargnées par le péché originel de la prédation, qui me semble pouvoir toucher tout le monde. Le même type d’erreur que celles commises par la démarche marxiste : à désigner le « bourgeois », le « réactionnaire », comme obstacle essentiel à une société égalitaire, on a sous-estimé les appétits destructeurs des cercles « progressistes » eux-mêmes. Certains ont mis du temps à convenir que les camarades soviétiques, chinois, cubains, n’avaient rien à envier aux dirigeants « impérialistes ».
Il semble que, sauf à les réguler, après en avoir pris conscience, nos appétits, besoins, désirs, nous poussent tous, aussi bien femmes qu’hommes, à privilégier nos intérêts, fût-ce au détriment de ceux des autres (c’est un peu une tendance de base du vivant …). Pas tout le temps et certains plus que d’autres, mais je crois artificiel et illusoire de distinguer les sexes en la matière.